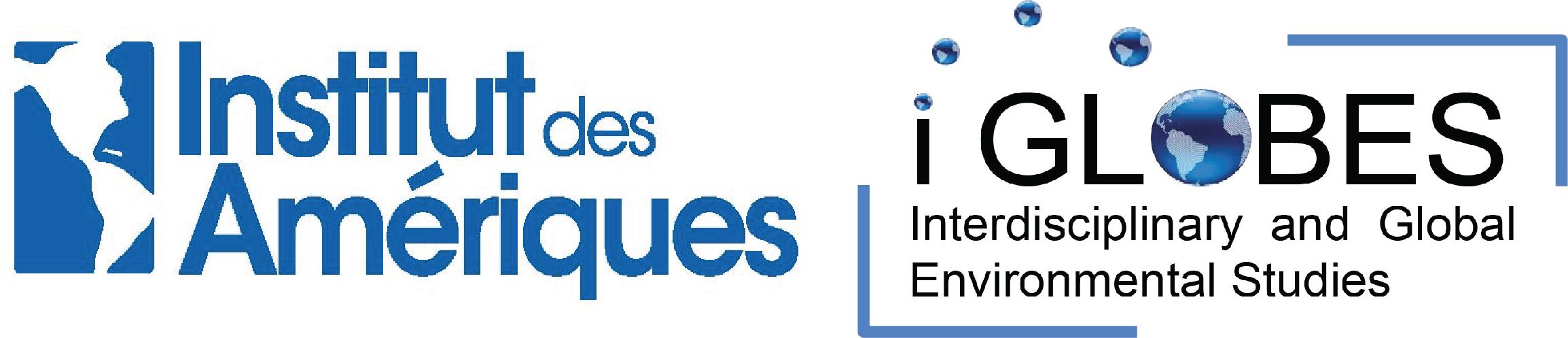C’est un autre monde, les mesures de quarantaine ne vont pas prendre là-bas… » Ce sont les premiers mots que j’ai écoutés à Cayenne lorsque, début mars, j’annonçais que je partais à Papaichton, à l’extrême ouest de la Guyane française, pour y réaliser ma recherche de terrain. J’allais y travailler avec les populations Boni, une des ethnies formées par les esclaves marrons du Suriname, qui se sont installés sur le fleuve Maroni après s’être rebellés et échappés des plantations du littoral au XVIIIe siècle.

Par chance, j’ai pu louer une chambre chez une « maman Boni » (c’est ainsi qu’on appelle les femmes plus âgées), qui cultive un abattis en pleine forêt amazonienne. Le lendemain de mon arrivée, elle me racontait « On ne voit pas grand-monde dans la rue. Tout le monde a peur de sortir sans le papier ». C’est ainsi que j’ai eu connaissance de l’Attestation de Déplacement Dérogatoire, et surtout de l’amende qui menaçait ceux qui seraient abordés par les gendarmes « sans avoir le papier ». Une jeune fille Boni m’a raconté qu’elle et ses amies partaient en courant lorsqu’elles voyaient les gendarmes faire de la prévention dans la rue…
Alors une routine de confinement s’est mise en place : aller à l’abattis quelques fois par semaine, faire les courses et rester à la maison le reste du temps. Il parait même que la production de manioc a augmenté : avec la fermeture des écoles, il y avait plus de main-d’œuvre disponible.

Le respect des règles m’a surprise, car cela contrastait avec ce que l’on m’avait annoncé… Il est vrai que l’on se croirait dans un autre pays, dans lequel on parle aluku tongo – la langue maternelle des boni -, où les femmes se vêtent de pagnes – le pangi -, où l’on produit du couac – une semoule de manioc -, où on se baigne dans le fleuve, et où les jeunes vendent du wassaï dans des sachets ou des bouteilles en plastique. Mais au-delà de ces images, c’est la précarité du système de soins qui éloigne ce territoire des représentations de la France : la ville ne dispose que d’un Centre de Santé avec deux médecins et quelques infirmières pour 8000 habitants. La pharmacie la plus proche se trouve dans la ville de Maripasoula, voisine… d’une heure et demie de pirogue ou deux heures de piste en mauvaise condition.
En cas de problème de santé grave, les patients sont transférés en hélicoptère jusqu’à Cayenne, car il n’y a pas de route entre l’intérieur et le littoral. A Papaichton, il n’y a pas non plus d’alcool gel, ni de tests pour le Covid-19. Néanmoins, le fait que le transport depuis les autres villes, déjà difficile, ait été interdit depuis la fin mars explique peut-être qu’aucun cas n’ait été confirmé ici. En compensation, la mairie et l’association locale « Fleuve d’hier et d’aujourd’hu » ont organisé la couture de masques de protection ; l’objectif est d’en produire suffisamment pour les habitants de Papaichton et Loka, le village boni le plus proche. Tout le matériel nécessaire a été transporté depuis Cayenne.
« Quelque chose de mauvais peut arriver à la famille » : l’état d’urgence boni

Un homme de l’ethnie N’djuka, un autre groupe marron de la région, est décédé, de vieillesse. Dès le lendemain, les femmes de son quartier, Cormontibo, se sont réunies en face de la Bashia Ousou, la maison d’appui pour les fêtes et la cuisine collective ; les hommes dans le Kee Ousou, le carbet mortuaire. Les kapiten, les chefs coutumiers, ont d’abord tenu une réunion avec la population, pour décider si la cérémonie traditionnelle de deuil devait avoir lieu, puis ils ont négocié avec les autorités « de la France », la mairie et les gendarmes. Il était fondamental que la cérémonie ait lieu, même moins fastueuse qu’à l’accoutumée : en hommage au défunt, mais surtout pour éviter les conséquences négatives, d’ordre spirituel, qui pourraient affecter sa famille si le rite n’était pas accompli dans les formes. Rien de plus dangereux qu’une âme ne pouvant trouver le repos et demeurant auprès des vivants : c’est l’état d’urgence des Boni.
Tout le matériel nécessaire à la réalisation de la fête a été transporté par le camion de la Mairie. Pendant trois jours et trois nuits, l’état d’urgence boni a prévalu sur la crise sanitaire globale. Personne n’a eu peur de sortir sans le papier. Et c’est là que j’ai compris. Comme me l’expliquait un employé de la mairie le jour de mon arrivée, « Ici c’est un autre monde, parce que c’est ‘le territoire des familles’. [Les gendarmes, les institutions publiques], tout le monde doit négocier, il faut être diplomatique, sinon on ne peut pas travailler. Il y a les lois de la France, mais ici ce sont les droits coutumiers qui prévalent ».
« Confinés » mais pas « enfermés » – réinterprétations locales du confinement
Normalement, ici on vit dans la rue, on sort pour discuter, on fait souvent la fête entre parents et voisins. Pour l’instant, les commerces et les bars sont fermés, à l’exception de ceux qui vendent des aliments. Les gens se replient, sur le pas de la porte ou dans les jardins. Pour autant, ces maisons ne sont pas forcément les leurs. « Je suis confiné, mais on ne peut pas m’enfermer », ai-je entendu un homme dire… Telle autre jeune fille s’affirme confinée, mais elle passe ses après-midis avec ses sœurs, sa mère et ses cousines. Elle amène ses enfants avec elle, pour qu’ils jouent avec les autres enfants de la famille. Il est très important de ne pas rester « tout seul »… ce qui a été la principale préoccupation des habitants à mon égard depuis le début.
« Être enfermé », plus que d’être associé au « chez soi », est associé à la solitude, qui est ressentie comme une violence. « Être confiné » est acceptable, si cela va de pair avec « être ensemble ». Pour que l’expression mentionnée par l’Attestation, « seules personnes regroupées dans un même domicile », trouve sens localement, tous les membres de la famille étendue se regroupent, de manière à être proches les uns des autres.
Dans le « territoire des familles », on vit ensemble, « Libi na wan ». C’est de cette manière que les mesures pensées pour la France trouvent sens dans la vie des Bonis, en les adaptant au sens de la famille, aux rites locaux et en négociation avec les autorités coutumières locales.
Papaïchton, Guyane française, le 18 mai 2020
P.S. je souhaite remercier le projet ANR GUYINT dans le cadre duquel se déroule cette recherche
Ce texte a été traduit du portugais par Stéphanie Nasuti, professeure de géographie au Centre de développement durable de l’université de Brasilia (CDS-UnB).
Yazmin Safatle est étudiante en anthropologie à l’Université de Brasília, sous la direction de Carlos Alexandre Barboza Plínio dos Santos et Stéphanie Nasuti. Elle est membre du Laboratoire Matula – Sociabilités, différences et inégalités.