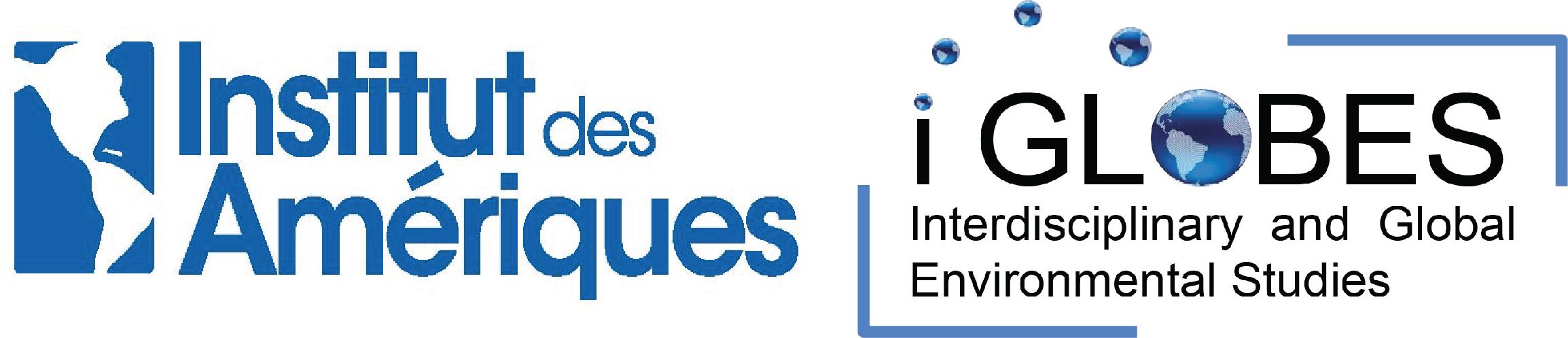Les rues de Guayaquil parsemées de cadavres abandonnés et les entassements de cercueils en carton resteront sans aucun doute parmi les images les plus insoutenables de la pandémie. Avec 3500 morts et plus de 38 000 cas confirmés sur une population de 17 millions d’habitants, l’Équateur est l’un des pays d’Amérique du Sud le plus touché par la COVID 19.
Les liens migratoires entre l’Équateur et l’Espagne ou l’Italie, où résident plus de 500 000 Équatoriens, ont contribué à la diffusion du virus, dans une période estivale marquée par le retour des étudiants et des travailleurs émigrés. La conjonction de l’épidémie de dengue avec celle de la COVID 19 peut également expliquer le débordement des services de santé. Enfin dans un pays où 45% des emplois se situent dans l’économie informelle, donnant lieu à une grande précarité, le respect des règles de confinement a été difficile.
Néanmoins, le drame équatorien surprend. Comment ce pays, qui avait fait depuis des années la promotion du Buen Vivir (le « bien vivre »), en est-il arrivé à laisser mourir des milliers de personnes ? Le débordement du secteur hospitalier et le désespoir d’une population impuissante sont aux antipodes des promesses d’un gouvernement qui promouvait depuis plus d’une décennie les valeurs d’épanouissement collectif. De plus, à l’heure où les scientifiques du monde entier alertent sur les relations entre destruction de la nature et épidémies, comment expliquer cette tragédie dans un pays qui prônait une relation harmonieuse entre l’homme et son environnement ? Le paradigme du Buen Vivir n’était-il que simple affichage ou marketing politique ? L’analyse des politiques menées depuis plusieurs années révèle un décalage croissant entre les promesses des discours et les programmes mis en œuvre.

Revenons aux origines de cette philosophie. La culture andine repose depuis des millénaires sur des cosmovisions d’origine indienne qui mettent la nature au premier plan. Connues sous le nom de Sumak Kawsay en Équateur, ou Sumak Qamaña en Bolivie, elles ont été traduites sous le nom de Buen Vivir. Définies comme « vie en plénitude » ou « vie en harmonie », elles livrent une vision du monde où la nature n’est pas subordonnée à l’homme. La terre est la Pacha Mama, mère nourricière qui doit être préservée et choyée par ceux qui dépendent d’elle. L’être humain n’y est pas oublié, mais il est conçu comme faisant partie de cette nature. L’entraide et le travail collectif sont les valeurs centrales et toute atteinte à la nature porte aussi atteinte à la communauté.
Récupérées par divers mouvements indigénistes et des élites politiques progressistes dans les deux pays andins à la fin du XXe siècle, ces cosmovisions ont été revendiquées comme une alternative au modèle de développement prédominant jusqu’alors, défini comme un maldesarrollo (mauvais développement) ou un malvivir (mauvaise façon de vivre). Avec la vague rose qui voit la victoire de la gauche en Amérique du Sud à l’aube du XXIe siècle, la philosophie du Buen Vivir est promue par les réformistes qui arrivent au pouvoir en Bolivie et en Equateur. Elle est alors transformée en paradigme politique et intégrée dans des Constitutions refondées, qui reconnaissent non seulement le multiculturalisme mais accordent aussi des droits à la nature. Il s’agit de construire l’État du Bien Vivre comme en attestent la Révolution citoyenne menée par Rafael Correa entre 2007 et 2017 ou les discours anticapitalistes et pro-nature de Evo Morales, d’origine aymara, à la tête de la Bolivie entre 2006 et 2019.
L’Équateur est-il pourtant parvenu à construire cette société du bien vivre ? L’un des points les plus problématiques concerne la protection de l’environnement. Si l’Équateur a bien institutionnalisé les droits de la nature, sa dégradation n’a pas cessé. Sous couvert d’un nouveau cadre idéologique appelé « néo-extractivisme » prétendant exploiter les matières premières pour en redistribuer les ressources aux populations via des programmes sociaux, les gouvernements ont poursuivi le saccage de la nature. L’abandon du projet Yasuni en est un signe emblématique : lancé en 2007 pour protéger la forêt amazonienne, ce projet prévoyait d’abandonner l’extraction du pétrole en échange de compensations financières. Il sera relégué aux oubliettes quelques années plus tard, faute d’engagement des bailleurs internationaux à financer ce programme pionnier.
Encouragé par sa croissance économique récente, l’Équateur s’est donc éloigné peu à peu des philosophies andines. Les niveaux de pauvreté se sont réduits jusqu’en 2015 mais les inégalités territoriales se sont accentuées et les dégâts environnementaux multipliés. De plus, une double dépendance a émergé : aux matières premières et à la Chine, l’un des principaux importateurs des ressources du pays et investisseur de poids dans les hydrocarbures. Dans le domaine de la santé également, les politiques du Buen Vivir n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le budget du secteur hospitalier a baissé de 34% entre 2017 et 2018, puis de 36% entre 2018 et 2019. La réduction du personnel médical n’a pas empêché le gouvernement d’expulser 400 médecins cubains en 2019, et les cas de corruption dans la gestion des hôpitaux se sont multipliés. Enfin, le taux de pauvreté est passé de 21,55% en 2017 à 25% en 2019. Il n’est donc pas étonnant que les Equatoriens se soient mobilisés massivement à l’automne dernier contre la hausse du prix des hydrocarbures, et la pandémie assène un coup supplémentaire à un pays déjà fragilisé. L’avenir s’annonce morose. Le FMI prévoit pour 2020 une violente récession et la CEPAL une pauvreté qui toucherait 31% de la population. Les inégalités devraient se renforcer avec la diminution des remesas (transferts monétaires envoyés par les Equatoriens de l’étranger) et la chute du prix du pétrole.

Faut-il en déduire que les politiques du Buen Vivir ont fait fausse route ? Une telle conclusion serait hâtive. L’Équateur a su ouvrir des pistes prometteuses. Retenons la reconnaissance institutionnelle des droits de la nature et de la diversité culturelle, la valorisation des patrimoines immatériels, l’éducation et la culture pour le plus grand nombre, ou l’ouverture de nouveaux espaces d’expression collective. Autant d’éléments qui resteront fondamentaux pour cicatriser les blessures.
Cergy, le 4 juin 2020
Diana Burgos-Vigna est maîtresse de conférences HDR en civilisation latino-américaine à CY Cergy Paris Université. Elle est rattachée au Laboratoire AGORA. Ses recherches portent principalement sur la gouvernance locale dans les villes latino-américaines. Elle est l’auteure de plusieurs articles sur l’Equateur:
- « Quito, a World Heritage City or a City to live in ? », City, vol.21, issue 5, 2017, pp. 550-567.
- « Quito, Patrimoine culturel de l’Humanité ou ville du Buen Vivir ? », dans Cahiers des Amériques Latines, dossier « L’Equateur de Rafael Correa : transition post-néolibérale et conflictualité », n°83, 2016, pp. 93-111