La gestion catastrophique de la crise sanitaire sous l’actuelle présidence de Jair Bolsonaro est, au-delà de la personne même du président, le révélateur d’inégalités socio-économiques structurelles, dont l’origine s’inscrit sur le temps long. Comment comprendre autrement ce paradoxe d’un virus, le SARS-CoV-2, qui a été introduit, comme en Équateur ou au Chili, par des membres des classes moyennes supérieures de la société – celles qui peuvent se payer le luxe de voyages aériens transatlantiques – mais dont les victimes appartiennent pour l’essentiel aux populations les plus modestes, parmi lesquelles figurent les peuples autochtones et les habitantes et habitants des favelas ?
Ce billet se propose donc de voir comment on peut éclairer la tragédie du présent à la lumière de certains aspects de l’histoire longue du Brésil, en usant ici du concept de nécropolitique. Par nécropolitique, ce concept que l’on doit à Achille Mbembé, grand théoricien de la pensée post-coloniale, il faut entendre cette capacité d’une autorité donnée à faire usage (de façon discriminante) du droit de vie et de mort sur les membres d’une communauté politique donnée[1].

La première victime officielle de la Covid-19 dans l’État de Rio de Janeiro a été Cleonice Gonçalves, 63 ans, décédée le 17 mars à Miguel Pereira, dans la grande banlieue de Rio. « Dona Cleo » était employée de maison et sa patronne, contaminée après un récent séjour en Italie, avait exigé qu’elle continue de travailler dans l’appartement du quartier « noble » du Haut Leblon, à proximité des célèbres plages d’Ipanema, où elle travaillait depuis une vingtaine d’années comme « diarista », employée domestique à la journée, un statut précaire. Lorsque les premiers symptômes de la maladie sont apparus, Dona Cleo fut enfin autorisée à rentrer chez elle : sa famille lui paya le taxi du retour mais il était déjà trop tard. Diabétique et très affaiblie, elle décéda le lendemain à l’hôpital.
Le travail domestique, l’un des héritages laissé par quatre siècles d’esclavage, est consubstantiel de la société brésilienne et de ses inégalités : il concerne plus de six millions de travailleuses, pauvres et métisses, pour beaucoup sans être déclarées, et donc sans droits. Pour leurs employeurs, leurs « patrons », c’est un marqueur d’identité, celle de ces classes moyennes et supérieures qui n’imaginent pas vivre sans domestiques, quand bien même beaucoup ont dû renoncer à les employer à demeure, de façon pérenne[2]. Alors que la pandémie s’abattait sur la ville, le maire de Belém a cru bon de classer la profession comme essentielle, et donc exempte des interdits liés au confinement – tant il semblait impossible pour nombre de familles de devoir se passer de leurs domestiques. On estime ainsi qu’un tiers des patrons a refusé de libérer leurs domestiques pendant le confinement.

À Rio de Janeiro comme dans toutes les grandes villes du pays, principaux épicentres de la pandémie, la plupart des domestiques habitent dans les favelas, ces bidonvilles installés sur des terrains occupés illégalement dans les périphéries des grandes villes ou les espaces interstitiels plus centraux – le cas de Rio étant ici spécifique, puisque les favelas les plus célèbres occupent les monts qui jouxtent et dominent les quartiers nobles, notamment dans la zone sud, huppée. Faire un détour ici par l’étymologie et l’origine de ce mot permettra d’offrir quelques éclairages intéressants sur la politique sanitaire au Brésil depuis l’avènement de la République, en 1889.
En botanique, la favela ou faveleira est un arbuste épineux à fleurs blanches que l’on trouve dans la caatinga, cette végétation caractéristique du sertão semi-aride, dans le Nordeste brésilien. Avant de donner son nom aux bidonvilles de Rio et, par extension, aux déclassés du pays, la favela désignait ce mont qui surplombait la vallée du Vaza-Barris, là où les armées républicaines avaient installé leur camp le temps de conquérir la citadelle rebelle de Canudos, dans laquelle s’était installée une forme de communauté politique, sociale et écologique qui dérogeait aux valeurs de la république positiviste et laïque. En 1897 et à l’issue de quatre expéditions, les armées y décimèrent les sertanejos qui s’y étaient rassemblés. La guerre se solda par un bilan humain terrible, sacrifiant la vie de milliers de paysans et de soldats pour sauver la république d’une soi-disant menace contre-révolutionnaire[3].
Les soldats démobilisés et leurs proches s’installèrent, de retour à Rio, sur le Morro da providência, bientôt rebaptisé Morro da favela, en souvenir de la guerre : la rapide expansion de l’habitat informel sur cette colline du centre-ville eut pour corollaire la diffusion dans l’espace public de représentations négatives vis-à-vis de ses habitants, pour la plupart métis ou noirs[4]. Peu à peu, tous les quartiers informels furent désignés sous ce nom et l’essor des favelas dans les grandes villes brésiliennes s’est accompagné tout au long du 20e siècle d’un discours stigmatisant, dénonçant en particulier l’insécurité et l’insalubrité. Et c’est au nom d’une politique hygiéniste que certains de ces quartiers informels vont être la victime de politiques urbaines de type haussmannien, au nom de l’ordre et du progrès. L’arasement en 1922, dans le cadre des festivités du centenaire de l’indépendance, du Morro do castelo, en plein centre de Rio, en est l’un des symboles[5].
Si les favelas ont pu faire l’objet plus récemment de politiques d’inclusion sociale et urbaine, notamment sous les présidences de Lula et Dilma, elles n’en restent pas moins des lieux où la valeur de la vie est moindre et c’est ce dont témoigne à nouveau l’actuelle crise sanitaire. Leur destruction n’est plus nécessairement de mise, mais la gestion de la crise sanitaire par l’actuel gouvernement témoigne du peu de cas fait de la vie des favelados. Ainsi, aux exactions des bandes criminelles, aux assassinats quotidiens commis par la police militaire – dont les homicides battent des records depuis quelques mois – s’ajoutent désormais l’abandon de l’État qui laisse les populations des favelas se débrouiller seules ou presque face au virus. Car le président Bolsonaro et quelques capitaines d’industrie préfèrent regarder ailleurs : la crise économique est à leurs yeux une urgence plus grande, tandis que la Covid-19 a longtemps été minimisée, et que la liste des morts (79.533 au 20/07/20) ne cesse de s’allonger, sans qu’une réelle accalmie ou une baisse de la contagion ne soit à cette heure constatée.
De Canudos à la Covid-19, la nécropolitique « à la brésilienne » continue de faire des ravages au sein des populations métisses, faveladas ou autochtones, au nom de l’Ordre (social) et du Progrès (économique), devise intangible de la République depuis 1889.
Toulouse, le 24 juillet 2020
Sébastien Rozeaux est maître de conférences en histoire à l’université Toulouse Jean Jaurès (FRAMESPA)
[1] « Le président actuel se présente comme un représentant de la ‘casa grande’, un soldat de la nécropolitique contre les peuples indigènes, les Noirs, les quilombolas, les populations pauvres et affamées. » Eduardo Mei, « La nécropolitique brésilienne et son origine dans la guerre de colonisation », 18 juin 2020.
[2] Camila Giorgetti, « Comment les catégories supérieures de São Paulo parlent-elles de leurs employées domestiques ? Analyse d’un rapport de classe », Brésil(s) [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 07 juillet 2020. Dominique Vidal, Les bonnes de Rio. Emploi domestique et société démocratique au Brésil, Presses universitaires du Septentrion, 2007.
[3] Euclides da Cunha, Hautes Terres (La guerre de Canudos), Paris, Métailié, 1993 (Os Sertões, 1902) ; Marco Antônio Villa, Canudos : o povo da terra, São Paulo,: Atica, 1997.
[4] Mattos, Romulo Costa, Pelos Pobres ! As campanhas pela construção de habitações populares e o discurso sobre as favelas na primeira República, Thèse d’histoire, Universidade federal fluminense, 2008.
[5] Menez, Alexsandro R., « Civilização versus barbárie : a destruição do Morro do Castelo no Rio de Janeiro (1905-1922), Revista Historiador, n°6, 2014, p. 69-81.
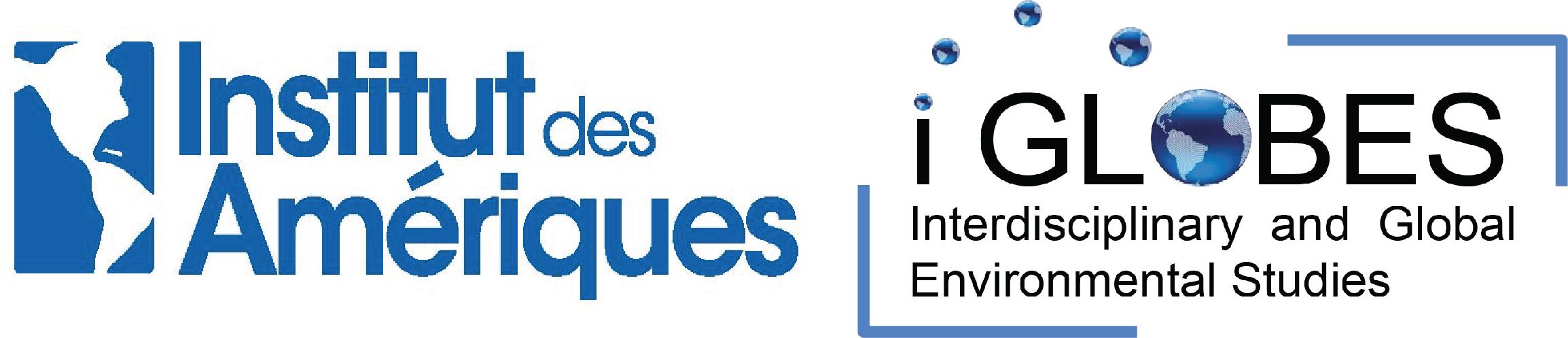

2 réponses sur « De Canudos à la covid-19 : nécropolitique et politique sanitaire au Brésil »
[…] Face à la croissance continue des cas de Covid-19 au Brésil, on peut observer de nouvelles configurations de trois technologies de pouvoir, pour emprunter un terme du glossaire foucaldien, dont la résultante est la destruction des plus pauvres. Dans Il faut défendre la societé (1997), Foucault fait la différence entre le pouvoir souverain, qui fait mourir ou laisse vivre, et le bio-pouvoir, qui fait vivre et laisse mourir. Mais Foucault ne postule pas qu’il existe un clivage irréversible entre la technologie du pouvoir souverain et celles qui lui ont succédé, et la réalité urbaine du Brésil est peut-être aujourd’hui l’un des meilleurs observatoires de comment le « faire mourir » se conjugue avec les artifices du bio-pouvoir, dans ce que Achille Mbembe appelle la « nécropolitique ». […]
[…] envers les travailleurs et les groupes les plus vulnérables, ce que certains qualifient de « nécropolitique ». Sur ce point, le gouvernement a clairement affirmé sa position vis-à-vis des populations […]