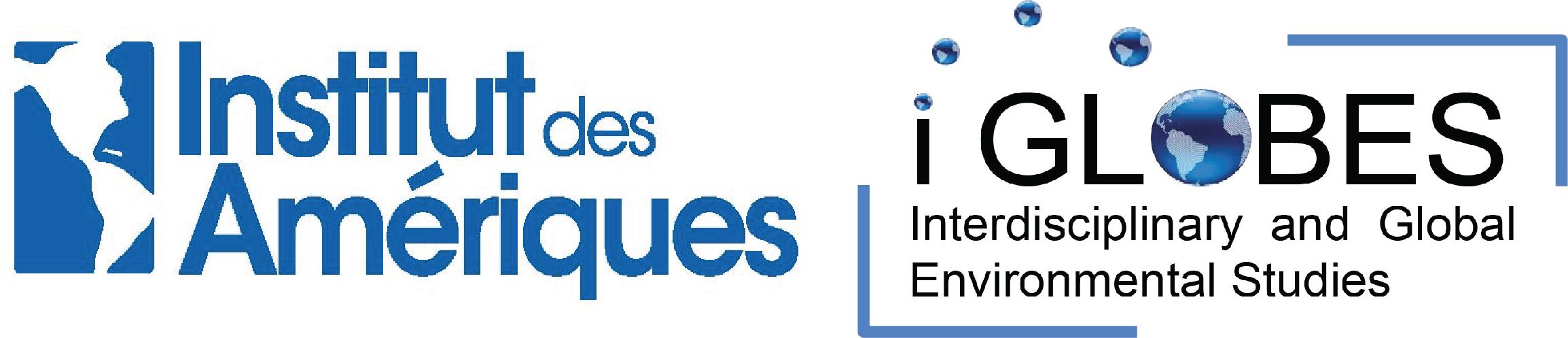Le 7 avril dernier, un quotidien français publiait une chronique intitulée « Pérou : arrêtés parce qu’ils faisaient de l’archéologie pendant le confinement ». Ce fait divers en apparence insolite cache en fait une réalité bien plus complexe. Avant la pandémie, l’archéologue Peter van Dalen avait entrepris des fouilles à Huacatón (près du nord de Lima), sur un site particulièrement menacé. Le 15 mars 2020 (date du début du confinement au Pérou), le chercheur a donc pris l’initiative de poursuivre son travail. Il affirme avoir fait part de son choix aux institutions culturelles locales, en leur assurant que la sécurité sanitaire de son personnel était garantie. Deux semaines plus tard, les autorités ont toutefois arrêté le chercheur pour cause d’infraction à la règlementation entourant le confinement, et de mise en danger de son équipe. Un mois après, le site était partiellement détruit par des travaux de voirie illégalement exécutés par un particulier .
Covid-19 et destruction du patrimoine archéologique
La destruction et le pillage de sites archéologiques (qui vont souvent de pair), sont la hantise des archéologues : afin de pouvoir retracer les faits du passé, ces derniers ont besoin de retrouver les vestiges tels qu’ils ont été laissés par les populations anciennes, ce qui n’est possible que par le recours à des techniques de fouilles minutieuses et ordonnées. Lorsqu’ils creusent, les pilleurs, uniquement à la recherche d’objets à forte valeur marchande, mélangent tout ce qu’ils trouvent. Ils détruisent ainsi tout espoir de parvenir à interpréter les restes des sites anciens.
Au Pérou, ce genre de pillage est loin d’être une nouveauté. Il remonterait au moins aux temps de la colonisation espagnole. Cette pratique est actuellement sanctionnée par des peines pouvant aller de 3 à 8 ans de prison. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, elle connaît néanmoins une recrudescence alarmante. Pour ne citer que quelques exemples, sur la côte nord du Pérou, c’est le cas à Portada de la Sierra (près de Trujillo), ou encore à Lambayeque. Dans les Andes, les autorités ont stoppé des fouilles clandestines menées en plein centre-ville de Cusco. En l’espace d’un mois, le gouvernement péruvien a reçu plus d’une cinquantaine de plaintes ; les cas de pillages seraient en réalité bien plus nombreux.
Deux facteurs pourraient expliquer ce phénomène :
Si le pillage de sites archéologiques peut être pratiqué comme un hobby éventuellement motivé par l’appât du gain (Canghiari, 2012[1]), la plupart du temps, il est surtout le fait de la pauvreté. Depuis le début de la pandémie, le Pérou est frappé de plein fouet par une crise économique qui semble partie pour durer. Pour les populations les plus défavorisées, le pillage d’objets archéologiques peut constituer une source de revenus alternative. Le confinement a en outre coïncidé avec la Semaine Sainte, qui, d’après une croyance populaire, est particulièrement propice à la découverte d’objets archéologiques à forte valeur marchande.

D’autre part, le confinement a paralysé le champ d’action des principaux acteurs qui en temps normal permettent de neutraliser les pillages : les forces de l’ordre et surtout, les fonctionnaires ainsi que les chercheurs des institutions culturelles et universitaires. Cela fait déjà plusieurs décennies que ces dernières déploient des efforts considérables aux côtés des communautés locales afin de lutter contre le pillage. Mais les projets qui sous-tendent ces initiatives sont en très grande partie financés par le tourisme local et surtout international. L’effondrement de ce dernier avec la pandémie laisse donc entrevoir une crise particulièrement grave pour les différents acteurs du secteur archéologique péruvien, et en particulier ceux qui luttent contre la destruction des sites. Autrement dit, le pillage archéologique semble avoir de beaux jours « post-covid » devant lui.

La lutte contre le trafic d’objets archéologiques : un parcours semé d’obstacles
Que deviennent les objets archéologiques pillés ? Certains sont achetés par des musées ou des collectionneurs privés au Pérou ; d’autres partent à l’étranger. Avant la pandémie, on estimait que l’équivalent d’un montant de 800 millions de dollars de biens culturels quittait illégalement le Pérou chaque année (Chamussy et al., 2011[2]). Ces objets se retrouvent le plus souvent en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse ou encore en Australie.

Dans le courant des dernières années, le renforcement des contrôles douaniers au Pérou et à l’étranger a permis d’intercepter un certain nombre de réseaux de trafiquants. En 2019, plus de mille biens culturels ont ainsi pu être rapatriés au Pérou. Malheureusement, beaucoup trop d’objets parviennent encore à passer entre les mailles du filet, pour rejoindre le très lucratif business des ventes sur internet, des marchés aux puces, des antiquaires, et bien sûr, des maisons de ventes aux enchères. La plupart du temps, ces dernières ne sont pas excessivement pointilleuses quant aux justificatifs de provenance des objets d’art précolombien.
De temps à autres, les ambassades des pays d’origine des pièces concernées tentent de stopper leur vente. Encore faut-il être en mesure de prouver que les pièces en question proviennent de fouilles clandestines, et qu’elles sont sorties illégalement de leurs pays de provenance. Cette tâche est extrêmement difficile voire impossible, en particulier pour les pièces retrouvées dans des sites méconnus ou encore circulant entre des collections privées depuis des décennies, comme cela semble avoir été le cas d’un lot de sept objets péruviens vendu le 29 juin dernier chez Christie’s à Paris.
La Convention de 1970 de l’UNESCO contre le trafic illicite des biens culturels n’est pas d’un grand secours dans ce cas de figure. Elle concerne en effet uniquement les pièces répertoriées sur les inventaires patrimoniaux des états membres, et ne s’applique donc pas aux objets issus de fouilles clandestines (Montenegro, 2015[3]). La Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés est beaucoup plus utile en ce sens. Elle n’a malheureusement été ratifiée que par très peu de pays.
Vers le « monde d’après » ?
La fouille de Peter Van Dalen en plein confinement a fait polémique au sein de la communauté archéologique péruvienne. S’ils ne cherchent pas à le justifier, les éléments exposés ci-dessous permettent en tout cas de mieux comprendre ce qui pourrait avoir motivé le choix du chercheur. Il est incontestable que les actions menées par les différents états et les organismes internationaux dans le courant des dernières années ont permis des progrès notoires en matière de lutte contre le trafic de biens archéologiques. Sur le continent américain, le Pérou et le Mexique sont les plus actifs dans ce domaine. Une réunion devait justement avoir lieu à ce sujet à Cusco en septembre prochain. Si elle est maintenue, il est fort probable que cette rencontre -à l’origine destinée à renforcer la règlementation internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels-, tiendra compte de l’urgence patrimoniale engendrée par la crise de la Covid-19.
La recrudescence de ces trafics en raison de la pandémie exige non seulement de consolider ces efforts, mais aussi de faire un pas de plus. Pour les pays d’origine de ces biens, cela doit passer par des sanctions à l’encontre des plus grands acheteurs d’objets archéologiques – souvent des personnages influents, haut placés sur l’échelle sociale. Pour les pays « destinataires » des pièces, il faut faciliter les restitutions d’objets aux pays d’origine, et s’investir davantage dans la ratification et l’application des conventions intergouvernementales. Enfin au niveau de la coopération internationale, il est nécessaire d’adapter les accords existants à l’évolution des atteintes au patrimoine culturel. Il s’agit certes d’un agenda ambitieux dans le contexte actuel, dont la mise en place prendra du temps. Rappelons tout de même qu’au-delà de tout aspect « patrimonial », dans des pays comme le Pérou, l’archéologie occupe une place significative dans l’économie nationale, par le biais du tourisme. Il s’agit donc bel et bien d’un secteur stratégique dans le cadre des plans de relance gouvernementaux. Il faut espérer que -tout comme pour l’environnement ou la santé-, la crise actuelle permettra de catalyser les initiatives locales et internationales destinées à sauvegarder cette richesse durable.
Lima, le 23 juillet 2020
Catherine Lara est archéologue à l’Institut Français d’Études Andines (UMIFRE 17 MEAE / CNRS USR 3337 América Latina)
[1] Canghiari, E. 2012 « ¿Huaqueros? Lamentablemente no tenemos: legitimación y reivindicación en el saqueo de tumbas prehispánicas ». In Espacios, tradiciones y cambios en Conchucos, S. Venturoli ed., pp. 36-65. Progetto Archeologico Antropologico “Antonio Raimondi”, Bologne.
[2] Chamussy V., Goepfert N., Touchard A. 2011 « La pratique de la huaquería au Pérou : un patrimoine détruit à 90% ». In Halte au pillage !, G : Compagnon & J.-L. Le Quellec (éds.), pp.314-333. Éditions Errance, Paris.
[3] Montenegro, N. 2015 “Introducción al tráfico ilícito de bienes culturales”. AFESE 61: pp. 113-128.