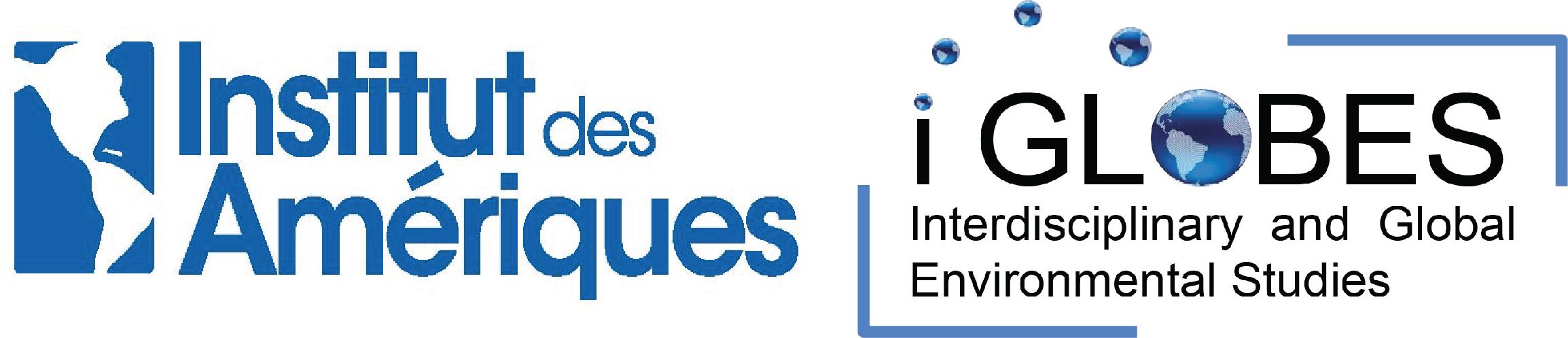À la mi-septembre 2020, le Guatemala enregistrait plus de 80 000 cas d’infections au coronavirus et près de 3 000 décès, avec une très forte concentration des cas dans la zone de la capitale, Ciudad Guatemala, ainsi qu’autour de la ville d’Antigua, les deux zones qui réunissent les plus fortes densités de population du pays. Début mars, le gouvernement du nouveau président Alejandro Giamattei, élu en août 2019 et entré en fonction en janvier dernier, a semblé réagir rapidement à la menace sanitaire en mettant en place un « État de Calamité » dès le 9 mars. L’annonce officielle du premier cas de Covid-19 a eu lieu quelques jours plus tard, le 13 mars suivant. De fortes restrictions furent adoptées à la suite et, le 23 mars, le gouvernement a décrété un couvre-feu sur l’ensemble du territoire, de 16 heures à 4 heures du matin, ainsi que l’interdiction quasi-totale des déplacements entre les départements du pays. Prévues initialement pour une semaine, ces mesures ont finalement été maintenues jusqu’à la fin du mois de juillet passant par différentes phases de durcissement et d’assouplissement. Depuis août, le pays réactive progressivement ses activités économiques, ses services publics – notamment les transports – et tente un retour à une forme de « normalité », malgré le maintien de l’État de calamité et la permanence de nombreuses contraintes. Le niveau d’approbation de l’action du gouvernement de la part de population est en baisse constante, avec moins de 40% d’opinion positive contre plus de 80% en avril dernier.
Comme c’est le cas dans de nombreux pays à travers le monde et en particulier dans les Amériques – y compris les pays supposément « développés » – au Guatemala la pandémie de Covid-19 a d’abord exposé de manière criante les profondes failles du système public de santé. Dans une première phase, la plupart des hôpitaux du pays ont traversé une grave pénurie de matériel, marquée notamment par l’absence d’équipement de protection (masques, visières et blouses) ou par des stocks périmés ou en mauvais état, notamment avec la présence de moisissures dans certains masques distribués au début de la crise. L’exposition aux risques de contamination pour les travailleurs de la santé s’en est donc trouvée accrue, et le nombre de morts de professionnels du secteur est à présent le plus élevé d’Amérique centrale, le pays déplorant le décès des suites du Covid-19 d’au moins 82 médecins au 8 septembre 2020. En outre, beaucoup ont dénoncé des retards de paiement (jusqu’à trois mois) sur leurs salaires, ainsi que la piètre qualité de la nourriture distribuée à leur intention et à celle des malades (là encore, de la moisissure a été retrouvée dans certains plats préparés).
Le manque de moyens pour le traitement des patients, à qui l’on a longtemps administré de simples cachets de paracétamol, a également été critiqué. À tout cela s’est enfin ajouté des difficultés liées à des problèmes récurrents de sous-effectifs, qui ont obligé les travailleurs de la santé à effectuer d’innombrables heures supplémentaires, alors qu’ils exercent déjà des métiers exigeants en termes d’heures consécutives ainsi que de fatigue physique et psychologique. Si la situation avait semblé se stabiliser depuis le mois de juillet, plusieurs actions de protestation ont été menées aux mois d’avril, mai et juin contre le gouvernement par le personnel médical, et les mobilisations reprennent avec plus de vigueur depuis septembre. Ce fut par exemple le cas dans le Parque de la Industría au cœur de la capitale (à l’endroit où un hôpital temporaire, disposant de très peu de moyens et réservé aux « patients Covid » a été installé) ou encore lors de la manifestation du 6 août qui s’est achevée par l’occupation temporaire du Ministère de la Santé. Plusieurs demandes ont été adressées au gouvernement de la part de différents groupes (groupements ponctuels de médecins, Collège de Pharmaceutique et Produits chimiques du Guatemala ou encore syndicat des travailleurs de l’Institut Guatémaltèque de Sécurité Sociale) qui sont restées lettres mortes. Plusieurs plaintes ont enfin été déposées auprès du bureau du Procureur des Droits Humains, qui s’est donné pour mission d’enquêter formellement sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. À la fin du mois de juin, le ministre de la Santé, Hugo Monroy fut d’ailleurs destitué, fortement critiqué pour le manque de transparence de son action face à la crise sanitaire. Issu du secteur privé, son manque d’expérience dans le domaine de la santé, son incapacité manifeste à gérer la crise et les accusations de corruption qui pèsent sur lui font planer de forts soupçons de népotisme pour expliquer sa nomination.

Source : Twitter / JusticiaYa, 13 juin 2020
Plus encore que la maladie elle-même, les mesures de confinement ont renforcé l’ampleur des inégalités sociales et de genre. Comme dans le reste du monde, les femmes guatémaltèques ont en effet particulièrement subi les effets de la pandémie et des contraintes qui en ont découlé. La violence et les viols se sont multipliés, du fait de l’enfermement, et la charge de travail domestique a fortement augmenté. Le fossé s’est également creusé entre les catégories sociales, moyennes et aisées d’une part – qui ont disposé de la possibilité de suspendre leurs activités professionnelles afin de s’isoler, ou de poursuvre leur travail à distance – et d’autre part le reste de la population, qui dépend d’un revenu quotidien qu’elle doit nécessairement gagner à l’extérieur du domicile. Dans un pays où l’économie informelle représente une part importante de l’économie totale (estimée à environ 30% du PIB), pouvoir se confiner semble ainsi davantage relever du luxe que de la norme. Dès la première semaine suivant la mise en place des règles de quarantaine, plusieurs zones urbaines paupérisées et certaines zones rurales faisaient déjà face à des pénuries alimentaires. L’application du couvre-feu a également montré que le poids des militaires dans la vie politique et quotidienne des Guatémaltèques était loin d’être chose du passé, puisqu’ils ont été fortement mobilisés durant toute la période où le couvre-feu a été imposé. Dans certaines municipalités (El Estor, Morales et Livingston dans le département d’Izabal; Panzós et Santa Catarina la Tinta, dans la région d’Alta Verapaz) l’ « État de calamité » se conjugue depuis juillet à la mise en place d’un « État de siège », sous couvert de lutte contre le narcotrafic, alors même que de nombreuses organisations locales récusent la nécessité de cette décision. Tout cela fait craindre une escalade vers la militarisation de ces zones, souvent majoritairement peuplées de communautés autochtones et où les luttes sociales et politiques liées à l’extractivisme sont particulièrement actives.

Source : Twitter / CUCGuatemala , 29 juillet 2020
Les populations autochtones représentent une très grande part de la population totale du Guatemala, bien que les insuffisances dans les recensements ne permettent pas d’avoir une idée exacte de leur nombre actuel. Pourtant, le gouvernement n’a mis en place aucune stratégie spécifique en termes de prévention ou de traitement du Covid-19 vis-à-vis des habitants des communautés les plus éloignées. Sur ces territoires, les vecteurs de la propagation du virus sont principalement les personnes ayant voyagé à l’extérieur du pays dans l’espoir de subvenir aux besoins de leurs familles qui ont été expulsées et sont de retour au Guatemala. A titre d’exemple, le 14 avril, près de 75% des passagers déportés d’un vol charter en provenance des États-Unis ont été diagnostiqué positifs au coronavirus. Si le flux des remesas est, contre toute attente, loin d’avoir diminué, il sera difficile pour les Guatémaltèques vivant à l’étranger, et particulièrement aux États-Unis, de maintenir ce niveau sur le long terme.
Les mesures d’urgence mises en place par le gouvernement ont été par ailleurs imposées de manière uniforme sur le territoire, notamment dans les zones rurales. Il n’y eut aucune consultation préalable des communautés – qu’elles soient mestizas ou autochtones – ni prise en compte des pratiques et des dynamiques sociales et commerciales des habitants, et aucun appui sur l’organisation locale de ces groupes. Il était souvent interdit de sortir pour aller travailler, ce qui a provoqué la perte d’emploi et de revenus réguliers pour de nombreuses familles. Les horaires des marchés paysans et populaires – pourtant généralement en plein air – ont été limités alors même que les supermarchés fonctionnaient comme à l’accoutumée. Certaines communautés en milieu rural pâtissent particulièrement du problème de la malnutrition, notamment celles qui se situent dans le « corridor sec » – là encore majoritairement autochtones. La crise vient enfin s’ajouter à une situation sanitaire déjà fragile du fait des nombreuses maladies véhiculées par les moustiques en période humide.
Si les travailleurs agricoles ont vu leurs opportunités de travail baisser drastiquement du fait des restrictions de déplacement, les grandes entreprises, à l’inverse, n’ont pas été sommées de cesser leurs activités. Les projets d’extraction minière, la construction de centrales hydroélectriques ou l’installation de tours électriques à haute tension, les plantations de monocultures de palmiers à huile ou de cannes à sucre, ainsi que les chantiers situés dans le corridor interocéanique ont continué de tourner à plein régime. Certaines de ces sociétés ne possèdent pas de permis d’exploitation ou d’extraction en vigueur voire sont l’objet de poursuites judiciaires, comme c’est le cas de la mine de nickel CGN Pronico située à El Estor, Izabal. Les différentes actions des défenseurs de droits ont de fait souvent connu des coups d’arrêt de par les restrictions de déplacement, tandis que les actions d’intimidation, de menaces et de coercition contre les dirigeants, les autorités autochtones et communautaires, ainsi que contre diverses organisations paysannes, des militants sociaux et même des journalistes se sont multipliées. Bien que le gouvernement ait mis en place une dizaine de programme d’assistance, leur mise en œuvre semble laisser particulièrement à désirer. Par exemple le Bono Familia, destiné à l’origine aux familles les plus vulnérables et duquel aurait bénéficié plus de 2,5 millions de foyers, a été l’objet de fortes critiques. Le manque de diffusion et de clarté de l’information relative aux conditions et à la marche à suivre aurait empêché un grand nombre d’individus d’en initier la demande. Les démarches passaient en outre nécessairement par des moyens numériques (téléphone ou internet), alors même que les personnes les plus vulnérables sont également celles qui souffrent le plus de la fracture numérique.

Source : Twitter / LaOllaCommunitaria, 18 mai 2020
Malgré un bilan global peu optimiste, la crise du Covid-19 a néanmoins montré que les différents groupes affectés par la crise et par les réponses souvent répressives et indifférenciées du gouvernement étaient loin d’être inactifs face à la situation. Certains groupes ont démontré une forte résilience et une solide capacité d’organisation, à commencer par les membres des communautés autochtones. Les initiatives de solidarité et les nouvelles formes de soutien ont en effet été renforcées comme par exemple, la collecte de nourriture pour aider les familles ou les communautés en quarantaine, l’autocontrôle collectif pour que la pandémie n’infecte pas les habitants des villages ou encore le rôle qu’ont tenu certaines autorités communautaires, qui ont eu la capacité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour prendre soin de la vie et de la santé des personnes.
La pandémie a ainsi souvent renforcé la conscience de l’importance de l’organisation locale, de la gestion indépendante de l’information, de revenir aux mesures traditionnelles de préservation de la santé collective, ainsi qu’à l’autosuffisance alimentaire. Les actions des dirigeants ont été documentées de près, décortiquées et souvent ouvertement critiquées dans les médias, bien que certains journalistes en aient parfois fait les frais. Les médias communautaires (presse, sites d’informations, radios…) n’ont eu de cesse de continuer à informer sur l’évolution des évènements dans les territoires les plus reculés. Enfin, des initiatives d’aide d’urgence ont vu le jour afin de pallier l’insécurité alimentaire. Par exemple dans le centre historique de Ciudad Guatemala, l’organisation « la olla communitaria » (la marmite communautaire) a distribué, à partir du 7 avril, plus de 100 000 repas durant près de 200 jours consécutifs. Elle a fait de nombreux émules dans plusieurs villes dans le pays, d’Antigua à Cobán ou encore Santa Lucía Cotzumalguapa. Elle vient néanmoins de mettre un terme à ses activités car la reprise économique diminue la disponibilité des bénévoles, mais ses membres rappellent que le problème de la faim est loin d’être résolu dans le pays.

Source : Instagram / laollacommunitariaca, 8 juillet 2020
En définitive et au vu des événements des derniers mois, la crise a souligné, voire accentué tout à la fois la faiblesse des institutions et le manque de transparence et d’efficacité de la gestion étatique par le gouvernement du pays. L’autoritarisme et l’arbitraire de certaines mesures ne sont en rien parvenues à freiner durablement l’épidémie, à contre-courant de ce que l’on a pu lire parfois, notamment à propos de la Chine, sur les bienfaits des contextes autoritaires pour freiner la contagion. Contrastant avec ce constat, le dynamisme de nombreux groupes de la « société civile » est apparu d’autant plus grand : associations professionnelles comme les syndicats et comités des groupes de travailleurs de la santé ; communautés organisées qui tout à la fois critiquent la gestion et les mesures mises en place et réclament des aides de l’État, mais aussi s’organisent pour remédier à ces manques ; ou encore initiatives de solidarité citoyenne d’urgence. Si elles mettent en lumière les failles de l’État, ces attitudes convergent également en cela qu’elles revendiquent des droits – à la santé, à l’information, à un niveau de vie digne, à la participation, à un traitement équitable de tous les citoyens… – qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux.
Finalement, le contexte de pandémie révèle l’ampleur de la diffusion de plus en plus large de l’idée du « droit à avoir des droits ». Pour autant, même lorsque ces acteurs sont tout à fait à même d’exercer leurs droits, l’État guatémaltèque et ses dirigeants ne parviennent pas, eux, que ce soit du fait d’une certaine faiblesse structurelle ou d’un manque de volonté politique, à les garantir.
Montréal, 7 octobre 2020
Garance Robert est doctorante en Science politique à l’Université de Montréal (CERIUM, CPDS, CRC Participation et citoyenneté), Coordinatrice de la chaire CERI-CERIUM Affiliée au CEMCA