Le 7 avril 2020, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré lors d’une émission télévisée que, puisque le gouvernement fédéral ne mettait pas à disposition les équipements sanitaires nécessaires pour combattre l’épidémie de Covid-19, son État utiliserait ses facultés « d’État-nation » pour se les procurer, ajoutant que la Californie pourrait même « exporter » ce matériel vers d’autres États fédérés. Le vocabulaire utilisé n’a pas manqué de faire sursauter un certain nombre d’observateurs : la Californie avait-elle subrepticement fait sécession ? Newsom accordait-il ainsi son soutien aux militants d’un « Calexit » ?
Bien entendu, le gouverneur démocrate, qui n’est pas né de la dernière pluie et a une carrière politique efficace derrière lui (il a été le maire de San Francisco puis le vice-gouverneur de Californie), avait très bien choisi ses mots et il ne remettait pas en cause l’unité des États-Unis. En pleine campagne électorale pour la présidentielle de 2020, il souhaitait alimenter à la fois un rapport de force personnel entre lui, une étoile montante démocrate, et le président républicain Donald Trump, et un rapport de force institutionnel entre la Californie et l’État fédéral.
Ce n’était cependant pas la première fois que Newsom employait ce terme « d’État-nation » à propos de la Californie, par lequel il entend exprimer la stature et le rôle de la Californie dans l’Union : un État fédéré, certes, mais qui par son économie et son poids démographique, peut et doit adopter des mesures audacieuses que pourraient suivre les autres États de l’Union. La fierté et l’exceptionnalisme du rêve californien ont souvent été au diapason ou à l’avant-garde du rêve américain. Mais, sous la présidence de Donald Trump, les priorités fixées par le gouverneur californien et ses alliés démocrates (couverture maladie accessible, protection de l’environnement, protection civique des minorités, droits des femmes et des homosexuels etc.) se sont trouvées opposées terme à terme avec celles de la Maison blanche.
De fait, depuis près de dix-huit mois, les conflits se sont multipliés entre la Californie et l’État fédéral, avec à la clé des arbitrages par les cours de justice sur les limites de la souveraineté des États fédérés et la Constitution. Les États de la fédération sont, par exemple, soumis à des contraintes budgétaires plus fortes que l’État fédéral (notamment du fait qu’ils ne contrôlent pas la monnaie). Certains programmes, comme la couverture médicale de base, sont en gestion conjointe avec l’État fédéral, et ils n’ont pas autorité sur les frontières.
Pour autant, Newsom, comme d’ailleurs d’autres avant lui, a essayé de pousser le plus loin possible les virtualités offertes par les ambiguïtés et les angles morts du fonctionnement fédéral, qui ne se règlent souvent que par de longues procédures judiciaires allant jusqu’à la Cour Suprême. C’est ainsi que la Californie a pu légaliser le mariage des personnes de même sexe (en 2008) et l’usage récréatif du cannabis (en 2016). Plus récemment, lorsque Donald Trump a déclaré l’état d’urgence à la frontière avec le Mexique et voulu mobiliser la Garde Nationale, le gouverneur californien la détourna de ce qu’il décrivit comme une « prétendue urgence » pour la redéployer vers des « menaces réelles » comme la protection des forêts contre les incendies.
L’exemple des régulations sur les émissions des véhicules montre bien comment le poids économique et démographique de la Californie lui permet de jouer avec les règles fédérales. Sous Obama la Californie avait été autorisée par l’agence fédérale de l’environnement (EPA) à adopter des standards plus stricts pour les voitures vendues sur son sol. Bien que Trump ait ordonné la révocation de cette dérogation, la Californie de Newsom a pu la prolonger dans les faits car son marché est si important pour les constructeurs que ceux-ci ont préféré conserver les standards plus exigeants que risquer d’être exclus du marché californien (et des Etats ayant adopté les mêmes règles) dans un avenir proche – par exemple en cas de victoire démocrate en 2020 ou en 2024…
Le rapport de forces entre Trump et la Californie a pris un tour encore plus dramatique avec la pandémie de Covid-19. Alors que le président, comme d’autres chefs d’États, minimisait la menace, Newsom s’est fait remarquer par des mesures relativement précoces, de nouveau justifiées en ayant recours au vocabulaire de l’État-nation. Si, mise au pied du mur, la Californie ne pouvait pas compter sur le « partenaire fiable » dont elle avait besoin, elle prendrait ses responsabilités. En toute indépendance.
Tout ceci n’est pas complètement nouveau si l’on adopte une perspective historique. Le fédéralisme étatsunien (et le fédéralisme plus généralement) pose en permanence la question des limites de la souveraineté des entités et de l’union. De célèbres débats ont entouré la ratification de la constitution en 1787 et la question de savoir si les États ont la possibilité de ne pas appliquer, voire d’annuler des lois fédérales a été plusieurs fois abordée au XIXe siècle. L’exemple le plus marquant est bien sûr celui de la guerre de Sécession, quand les États esclavagistes du Sud décidèrent de quitter l’Union après l’élection d’un président dont les positions, jugeaient-ils, menaçaient leur « liberté » d’avoir des esclaves. On peut d’ailleurs se souvenir qu’à cette occasion, si les États de la côte Pacifique soutinrent l’Union (notamment la Californie avec son or abondant) ils formèrent aussi un éphémère projet de « république du Pacifique » indépendante.
Si la victoire du Nord pendant la guerre de Sécession marqua un tournant, elle ne mit pas un terme au débat et les conflits se poursuivirent pendant tout le XXe siècle, comme autour du New Deal, de l’organisation de la production de guerre ou des droits civiques.
Dans le cas de la Californie, ces controverses se nourrissent aussi de l’histoire du fédéralisme mexicain et des premières velléités d’indépendance californiennes, qu’on retrouve bien plus tard représentées dans les épisodes et films de Zorro (et que le héros déjoue, en bon légitimiste).

Avant d’être annexée par les États-Unis en 1848, après la guerre américano-mexicaine, la Californie appartenait en effet au Mexique, qui fut un État fédéral entre 1824 et 1835 (et l’est redevenu ensuite). La Californie n’y était pas un État de plein exercice mais un Territoire sous la tutelle du gouvernement fédéral. Cependant, on avait fait miroiter aux Californiens la possibilité de devenir un État à part entière avec le temps. Aussi quand la majorité changea et fit adopter un système de gouvernement centralisé en 1836, la Californie déclara son indépendance tant que le Mexique ne redeviendrait pas une fédération ; les Californiens allèrent même jusqu’à proclamer « l’État libre et souverain de Haute-Californie ». Finalement, les meneurs du soulèvement acceptèrent de se rallier après avoir réalisé que, vu la distance entre la capitale et leur territoire, le gouvernement ne se mêlerait guère de leurs affaires. A l’époque également, vu le peu de ressources locales, le peu que le gouvernement central pouvait apporter serait toujours bienvenu.
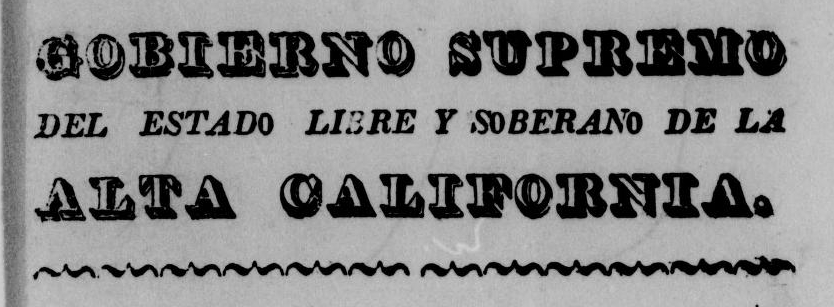
À ce moment-là, un ralliement aux États-Unis à la manière de celui en cours au Texas n’était pas tellement d’actualité. La question de l’avenir national de la Californie allait se poser plus sérieusement dans les années 1840. Le Mexique s’avérait avoir de moins en moins de moyens pour assurer la sécurité de cette frontière lointaine et les États-Unis convoitaient explicitement la région car les circulations maritimes et continentales dessinaient des possibilités nouvelles de liaisons Est-Ouest.
Dès 1846, au moment où la guerre entre le Mexique et les États-Unis menaçait, quelques pionniers étatsuniens installés dans la vallée centrale de Californie déclarèrent l’indépendance d’une « république de Californie », à l’imitation du Texas. Ils hissèrent un drapeau de fortune, figurant un ours, qui inspira celui adopté lors de l’intégration de la Californie dans la fédération des États-Unis en 1850, après le début de la ruée vers l’or et alors que les étasuniens n’étaient plus une poignée mais plusieurs dizaines de milliers. Pour les Californiens d’origine mexicaine, en revanche, ce drapeau représentait une humiliation puisqu’il rappelait la conquête américaine, précédée par un soulèvement illégitime et marquant le début d’une ère où ils n’auraient plus le contrôle sur leur territoire. Certains voient aujourd’hui dans une possible indépendance une certaine revanche, puisque la population d’origine mexicaine est majoritaire en Californie.
Newsom est aujourd’hui à la tête d’un État qui a bien davantage de ressources, mais comme les Californiens de l’époque, sa vision met en avant les intérêts de son État d’abord, quitte à marcher sur les brisées de l’Union.
Observer les États-Unis amène à s’habituer à raisonner à une échelle continentale, mais l’exemple de la Californie montre bien l’intérêt de ne pas oublier d’observer à l’échelle des États fédérés. Il est même intéressant d’aller un peu plus loin et de regarder à l’échelle des comtés et des villes, comme le montrent les bras de fer sur les conditions de la fermeture et de la réouverture des espaces publics (notamment, des plages).
La tendance à un affrontement entre gouvernements centraux et pouvoirs locaux est visible partout dans le monde suite à la pandémie de Covid-19. Dans l’ouest des États-Unis, elle confirme un particularisme déjà très ancré et pourrait éventuellement démarrer un processus bien plus fort. La fiction a déjà exploré la possibilité d’une scission californienne : dans Ecotopia (1975), Ernest Callenbach imagine qu’en 1980 la côte Ouest des Etats-Unis a fait sécession du reste de l’Union pour des raisons écologiques ; dans American War (2017), Omar el Akkad décrit une deuxième Sécession du Sud, après l’interdiction fédérale des hydrocarbures… Comme dans ces livres, nous sommes dans une conjoncture fluide, où les possibles semblent se rouvrir. Les choix faits dans le passé se posent de nouveau, les arrangements d’aujourd’hui ne semblent plus éternels, les alternatives du passé reviennent hanter le présent, et l’avenir.
Toulouse, le 15 mai 2020
Emmanuelle Perez Tisserant est maîtresse de conférences en histoire à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès au sein du laboratoire Framespa. Elle a réalisé son doctorat dans l’unité Mondes américains et obtenu le prix de thèse IdA en 2015.
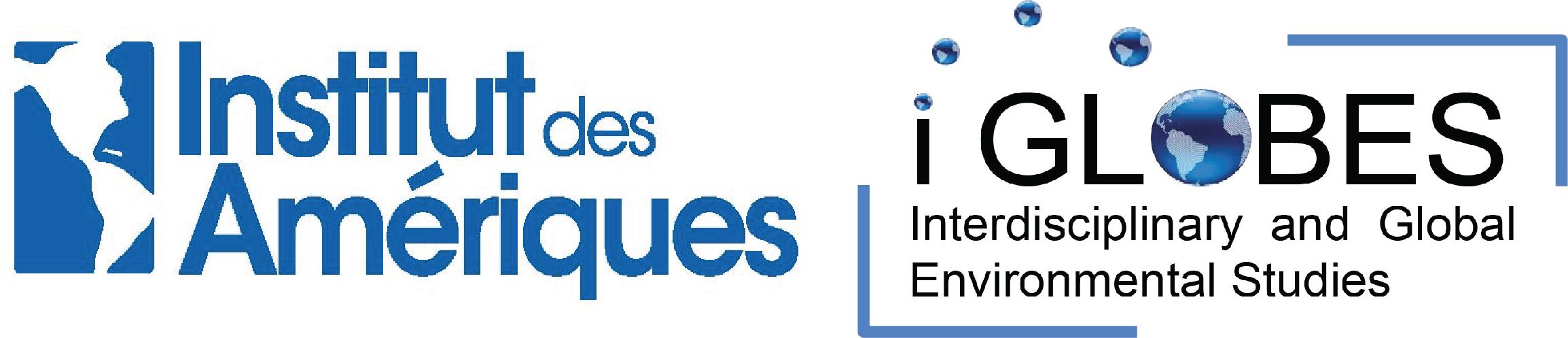

4 réponses sur « La Californie est-elle un « État-nation » ? »
[…] Gavin Newsom, a déclaré que son État serait obligé de se procurer du matériel sanitaire en sa qualité « d’État-nation », puisque le gouvernement fédéral ne s’en chargeait pas. En l’absence d’une coordination […]
[…] Emmanuelle Perez Tisserant est maîtresse de conférences en histoire à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et a été lauréate de la bourse Lurcy en 2009. Elle évoque le statut de la Californie sur le blog de l’Institut des Amériques consacré au Coronavirus : « La Californie est-elle un « État-nation » ? ». […]
[…] La chute de Donald Trump dans les sondages pourrait être le dernier acte d’une tragi-comédie qui a secoué la société américaine depuis quatre ans : un Président à la fois germophobe et xénophobe voit son avenir politique compromis par une pandémie mondiale originaire de la Némésis chinois, puissance rivale ciblée par le nationalisme économique trumpien. À première vue, l’émergence d’un fléau international menaçant les frontières américaines semblait pourtant s’inscrire parfaitement dans le récit nationaliste du « carnage américain » imaginé par le président américain dans son discours inaugural. Pourtant les liens entre la pandémie, le nationalisme économique et la mondialisation sont complexes, qui plus est au sein d’un modèle fédéral où l’action des états et des villes priment parfois sur l’intervention fédérale (sur ces dynamiques locales, lire les contributions respectives sur Covidam de Victoria Gonzalez Maltes et d’Emmanuelle Perez Tisserant) […]
[…] Lors de son discours sur l’état de l’État (State of the State address) de février 2020, le gouverneur Gavin Newsom a longuement décrit les causes de cette situation, du manque chronique d’investissements dans […]